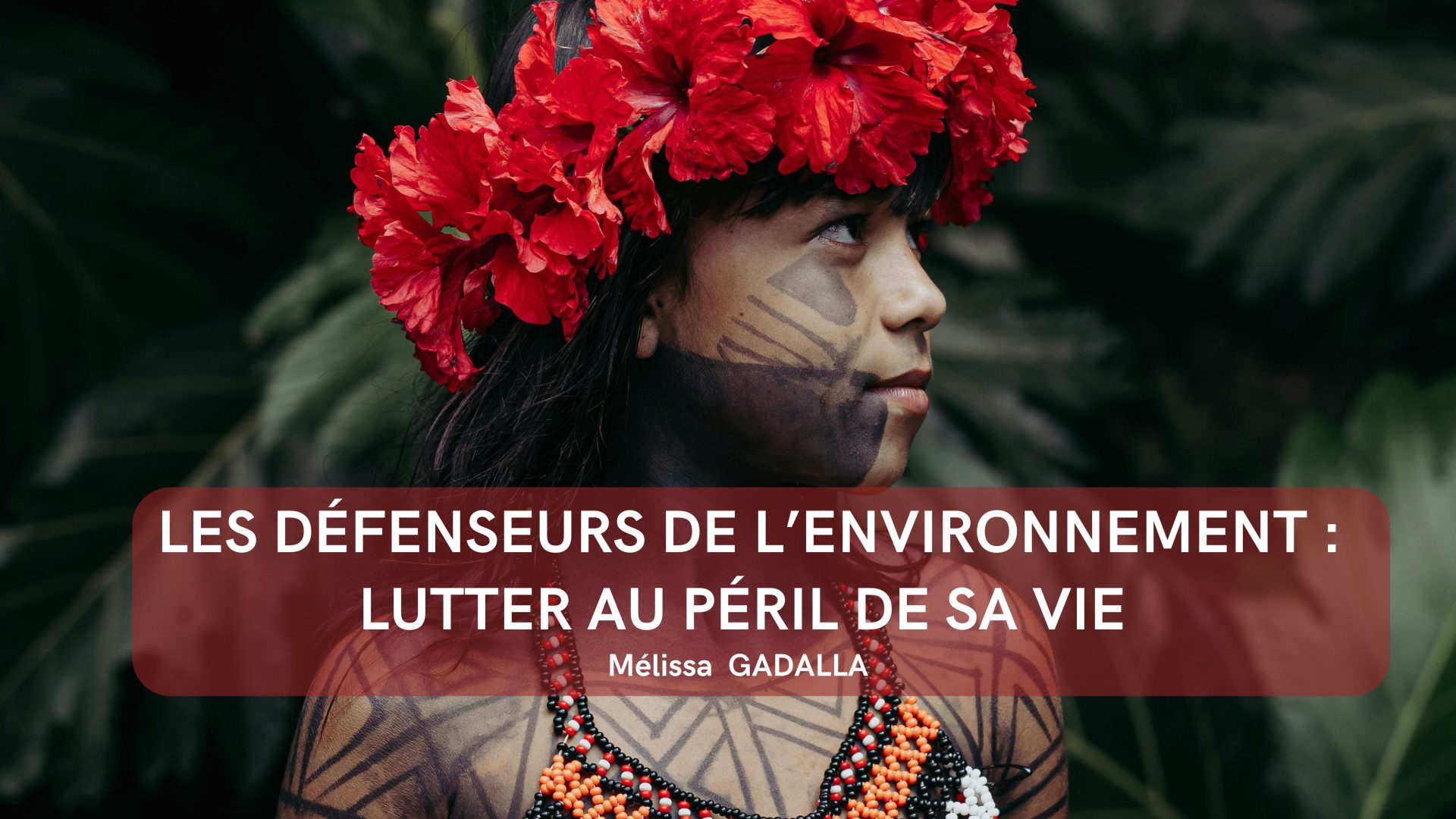Article de Mélissa Gadalla (MS EEDD parcours IGE 2023-24)
Introduction
Ils se battent pour la protection des droits autochtones, de la biodiversité, des rivières et des forêts, la préservation des terres et des ressources, contre l’exploitation intensive, la déforestation illégale et l’extraction minière. Ils sont souvent autochtones, paysans, gardes forestiers, mais aussi parfois avocats ou journalistes, focus sur les combats de ces défenseurs de l’environnement, parfois au sacrifice de leur vie.
Certains sont emblématiques : les luttes qu’ils ont menées durant leur vie les ont mis au devant de la scène, et parfois, leur assassinat les ont rendu tristement célèbres. Il s’agit des défenseurs œuvrant pour la cause environnementale et celle des peuples, parmi lesquels certains grands noms font écho : Chico Mendes, Paulo Paulino Guajajara, Dorothy Stang et tant d’autres.
Cependant, cette liste ne se limite pas, loin de là, aux noms qui résonnent dans la mémoire collective. Cette liste est longue, et s’allonge chaque année de plusieurs centaines de nouveaux noms. Les chiffres de Global Witness, une ONG britannique spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays en développement et la corruption politique, en témoignent. Selon son recensement, en 2022 seulement, ce sont 177 activistes qui ont été assassinés, en grande partie des autochtones. Les coupables présumés – pas toujours officiellement identifiés et certainement pas suffisamment poursuivis en justice – sont des exploitants illégaux, braconniers ou industriels dont l’appât du gain n’a pas de limite.
Ces assassinats par des groupes armés ou tueurs à gage sont souvent l’épilogue des nombreuses tentatives d’intimidation, menaces et attaques dont les activistes sont la cible. Les chiffres du recensement de Global Witness pourraient en réalité être bien plus élevés, puisqu’il est impossible de comptabiliser avec certitude l’ensemble des personnes assassinées ou encore celles portées disparues dans l’exercice de leurs combats. Les enfants ne sont pas épargnés, cinq d’entre eux ont été tués en 2022 en Amérique du Sud et en Amérique Centrale. Aux douloureuses premières places du classement des pays les plus touchés, nous trouvons en majorité des nations d’Amérique du Sud, avec la Colombie, le Brésil, le Mexique et le Honduras. L’Asie n’en est pas exempte, 16 militants y ont été assassinés cette même année, dont 11 aux Philippines seulement.
Mais alors qui sont ces activistes, quels sont leurs combats, et qu’en est-il de leur héritage et de leur mémoire ?
Selon Marine Calmet – juriste engagée dans la protection de l’environnement et des droits des peuples autochtones – bien qu’ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ces peuples sont présents sur un quart de la surface terrestre, où se concentre 80% de la biodiversité mondiale. Défendre les droits des autochtones et défendre l’environnement sont alors des combats qui se rejoignent. Philippe Descola, un anthropologue français connu pour son travail autour de la relation entre l’humain et la nature, explique par ailleurs que les Amérindiens voient les populations animales et végétales comme un ensemble social avec qui ils cohabitent en harmonie dans la forêt. Les animaux et les végétaux, comme les hommes, ont une âme.
Les humains sont ainsi en interaction permanente avec ces êtres dont ils dépendent, qu’il faut connaître, respecter, et avec lesquels il faut vivre en équilibre. En opposition, traiter l’environnement comme un objet extérieur à l’Homme, selon l’anthropologue, a pour résultat de détruire cet environnement à un rythme frénétique.
Les menaces sur ces équilibres apparaissent alors nombreuses, la plupart du temps d’origine anthropique, à commencer bien entendu par le dérèglement climatique lié aux activités humaines, avec toutes ses conséquences, directes et indirectes. La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité (IPBES, aussi connu comme le GIEC de la biodiversité), identifie dans son premier rapport global sorti en 2019 cinq grandes causes de l’effondrement de la biodiversité : la destruction des milieux, la surexploitation des espèces, le changement climatique, les pollutions et les espèces invasives.
Les peuples autochtones se retrouvent au premier plan d’innombrables pratiques humaines délétères, souvent poussées à l’extrême : le trafic de bois, le braconnage, la déforestation pour l’installation de fermes d’élevage et de plantations de soja, l’extraction de ressources minérales, l’exploration pétrolière, la recherche d’or, etc. Les menaces deviennent ainsi économiques, lorsque les intérêts financiers d’exploitants, d’industriels, ou de propriétaires terriens, sont mis à mal par les combats d’activistes en faveur de la protection des peuples et de l’environnement. Les menaces sont aussi et surtout politiques, à travers l’inaction des pouvoirs à différentes échelles, ou pire encore, à travers des actions et discours alimentant directement le climato-scepticisme ou allant à l’encontre de ces luttes déjà complexes à mener.
A l’instar de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, ouvertement climato-sceptique et favorable à l’exploitation minière et forestière en Amazonie, qui avait déclaré en 2015 qu’« il n’y a pas de terres autochtones où il n’y a pas de minerais. L’or, l’étain et le magnésium sont dans ces terres, en particulier en Amazonie, la zone la plus riche au monde. Je n’entrerai pas dans cette manie de défendre la terre pour les Indiens » (Campo Grande News, 22 avril 2015).
Plus tard en 2019, cette fois-ci lors de sa première intervention à l’ONU, le président brésilien de l’époque avait déclaré qu’il était « faux de dire que l’Amazonie appartient au patrimoine de l’humanité, et c’est une erreur des scientifiques de dire que notre forêt est le poumon de la planète ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Conséquence directe, entre 2019 et 2022 – lors de son mandat – la déforestation avait augmenté de près de 50% dans la région amazonienne, atteignant 34 000 km² de destruction supplémentaire durant cette période. Dans le contexte de la toute récente COP16 sur la biodiversité (clôturée en novembre 2024), l’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN) a mis à jour la liste rouge répertoriant des espèces, végétales et animales, menacées d’extinction.
Aujourd’hui, « 44% des coraux constructeurs de récifs, 41% des amphibiens, 34% des conifères et 26% des mammifères risquent de disparaître à l’échelle planétaire ». Ces systèmes de destructions, à l’instar de la déforestation excessive, ont des conséquences très concrètes sur les peuples autochtones. Il est difficile de compter le nombre de peuples menacés. Au Brésil, de nombreux groupes autrefois isolés sont désormais exposés aux risques liés à ces systèmes d’exploitation : les Awa, les Akuntsus et les Kanoês, tous menacés de disparition. Un passionnant dossier porté par Survival International relate les destins de ces peuples, menacés par des violences qui n’ont malheureusement pas de frontières, dont nombreux peuples sont victimes dans des pays d’Amérique du Sud ou en Asie. D’un pays à l’autre, quelles formes ont pris les résistances à l’exploitation et la destruction ?
Retour au Brésil.
Paulo Paulino Guajajara, âgé d’une vingtaine d’années, luttait pour la protection de la forêt amazonienne face à l’infestation de la déforestation illégale et contre l’exploitation des ressources naturelles. Ce fervent militant faisait partie de la communauté des Guajarara, l’un des plus grands peuples autochtones du Brésil, principalement présent dans l’État du Maranhão. Au sein de cette tribu s’est constitué en 2012 un groupe de défense de la forêt amazonienne, Les Gardiens de la forêt. La vocation de ce mouvement – devenue l’ONG Gardiens de la forêt – est d’empêcher l’exploitation forestière illégale et l’expansion agricole dans la réserve d’Arariboia du Maranhão, grâce à l’organisation de patrouilles de surveillance.
Ce territoire est également le lieu d’habitat du peuple Awa, un groupe de chasseurs-cueilleurs nomades, dont une partie reste sans contact avec l’extérieur, sans défense immunitaire – ainsi victimes de maladies apportées et de la destruction de leur terre au profit de l’exploitation. Les gardiens de la forêt déplorent depuis longtemps l’invasion progressive de la déforestation et l’inaction face aux nombreux signalements faits auprès des autorités (police fédérale) et institutions (Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables).
Ces gardiens se relaient pour ces patrouilles dans les zones à protéger, de nuit comme de jour, au péril de leur vie. Une dizaine de ses membres combattants ont été tués ces dernières années, et l’assassinat de leur leader est l’aboutissement de nombreuses menaces de mort dont il a été la cible au fil des années. Cet homme qui a dédié sa vie à défendre l’Amazonie a été victime d’une embuscade menée par des bûcherons illégaux. Paulo Paulino Guajajara avait en effet déclaré à l’agence Reuters, quelques années auparavant :
« J‘ai parfois peur, mais nous devons lever la tête et agir. Nous sommes ici pour nous défendre. Nous protégeons notre terre et la vie qui s’y trouve, les animaux, les oiseaux, et même les Awá qui sont ici aussi. Il y a tellement de destruction de la nature, des bons arbres avec du bois aussi dur que de l’acier sont abattus et emportés. Nous nous devons de préserver cette vie pour le futur de nos enfants ».
Ce devoir, il s’en était emparé pour pallier l’inaction des autorités locales. Les récits de ce type sont nombreux. Chacun d’entre eux relate des combats menés par des activistes au sacrifice de leur vie.
Des combats menés par des activistes au sacrifice de leur vie.
Chico Mendes, lui, est connu pour son engagement tout au long de sa vie en faveur de la préservation de la forêt amazonienne, menacée par la déforestation massive due à l’exploitation du bois, à l’agriculture et à l’élevage. Il tenait notamment un grand rôle dans la création de zones protégées où les communautés locales pouvaient continuer leur activité traditionnelle. Cible de nombreuses menaces de mort, il est tué en 1988, un assassinat prémédité par les propriétaires terriens dont les intérets économiques était mis à mal par son combat syndicaliste. Chico Mendes luttait pour les droits des seringueiros dont sa famille est issue, des ouvriers recueillant le latex dans les plantations d’hévéa en Amazonie.
Dorothy Stang, une américaine écologiste et religieuse, naturalisée brésilienne, se battait pour la protection des paysans autochtones et contre l’élevage intensif en forêt amazonienne. Assassinée par des tueurs à gage en 2005 pour ses prises de positions publiques contre ces pratiques.
Berta Caseres, militante hondurienne de la communauté Ienca, pour la protection des terres des peuples autochtones et des rivières, assassinée en 2016 parce qu’elle s’opposait à des projets d’installations hydroélectriques menaçant les terres et ressources de peuples autochtones. Les relayeurs de l’information ne sont pas épargnés. Selon une enquête de l’UNESCO de 2024, sur près de 900 professionnels spécialisés dans le journalisme environnemental, 70% d’entre eux déclarent avoir déjà été la cible de menaces, à travers des agressions physiques, des attaques en ligne, ou encore des poursuites judiciaires. C’est le cas de Javier Valdez Cárdenas, un journaliste mexicain couvrant le crime organisé et l’impact des violences liées aux narcotrafics sur l’environnement. Il a été assassiné en 2017 en représailles de ses prises de parole.
Mais qu’en est-il de la dénonciation des systèmes rendant nécessaires ces activismes et de la représentation politique de ces causes ? Ou encore de la mise en lumière de ces combats si courageux, de la mémoire de ceux qui les mènent, et de l’héritage de leurs luttes ? De nombreux mouvements permettent d’instaurer une certaine reconnaissance en mettant en avant ces combats à l’échelle internationale. C’est en partie à travers les travaux d’ONG et d’associations, de journalistes, ou encore d’organismes de distinction, que ces combats sont rendus visibles, tout comme les crimes qui les rendent nécessaires.
A l’instar de Global Witness, que nous avons déjà évoqué, une ONG qui mène un effort remarquable de mise en lumière à travers un travail d’investigation et des campagnes de plaidoyer. Le Prix Goldman pour l’Environnement, récompense pour sa part les activistes de terrain, les personnes et groupes contribuant à la protection de l’environnement à travers un activisme bénévole et exceptionnel. Chaque année, ce Prix Nobel écologique distingue des héros de l’environnement et attire l’attention sur la violence dont ses défenseurs sont souvent victimes.
Plusieurs de ses lauréats ont d’ailleurs été assassinés, c’est le cas – entre autres – de Paulo Paulino Guajarara, de Berta Caceres, et de Chico Mendes, à qui le prix a été décerné à titre posthume. Dorothy Stang a pour sa part reçu à titre posthume également, en 2008, le prix des Nations unies pour la cause des droits de l’homme. De son côté, l’ONG Survival International prône la défense des droits des peuples indigènes, en agissant dans le monde entier au sein de nombreuses communautés et avec des organisations indigènes locales, et en dénonçant les injustices dont certains peuples sont victimes.
Sur le plan politique, l’avancée se fait à petits pas.
La représentation des peuples et de l’environnement est un défi majeur. Sônia Guajajara, une militante autochtone issue du peuple des Guajajara, a été nommée ministre des Peuples autochtones en janvier 2023, sous le gouvernement de Lula, qui avait alors inauguré cette toute nouvelle institution.
Selon les mots de la première occupante à ce poste, cette nomination est « une conquête collective des peuples indigènes, un moment historique pour le début de la réparation au Brésil. La création du Ministère est la confirmation de l’engagement que Lula assume ». Depuis le retour de ce dernier à la tête du pays, le Brésil connaît un recul de plus de 30% de la déforestation en Amazonie, par comparaison entre 2023 et 2024.
L’objectif d’ici à 2030 : zéro déforestation dans un des principaux poumons verts de notre planète. Ce virage à 180 degrés par rapport aux dégâts causés par le gouvernement de Bolsonaro montre incontestablement l’importance de l’incarnation politique des luttes écologiques. En Colombie, d’anciens combattants FARC incarnent également ces luttes en œuvrant à présent pour la protection de la forêt amazonienne ; à l’instar des membres de la coopérative Comuccom, qui a établi en 2019 une pépinière de plusieurs dizaines d’hectares dans le sud-ouest du pays, visant à la préservation d’espèces végétales endémiques. Une cause noble qui s’est soldée par une énième tragédie : en 2022, leur président est assassiné par un des groupes armés s’affrontant dans la zone. Un des noms qui fait donc partie de la longue liste du rapport Global Witness sur les 177 activistes assassinés en 2022.
Conclusion
Dans un registre malheureusement similaire, concluons en mettant en lumière une combat cette fois professionnel. Depuis quelques années, les observateurs de bateaux de pêche en mer sont de plus en plus exposés à des dangers du même ordre. Ils exercent un métier peu connu du grand public mais essentiel : leur travail d’observation des bateaux de pêche en activité permet de surveiller les pratiques des pêcheurs en mer et d’en détecter les abus, notamment ceux liés à la surpêche.
Là encore, la dénonciation de pratiques délétères pour la biodiversité marine ou de délits environnementaux est parfois fatale : en 2023, le corps mutilé de Samuel Abayateye, un observateur ghanéen, a été retrouvé en mer. En l’espace de dix ans, quinze de ces observateurs ont disparu ou sont morts dans des circonstances troubles. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast produit par France Inter : Observateurs de pêche : enquête sur un métier à risque.
–
Sources
Global Witness ; Standing firm: the Land and Environmental Defenders on the frontlines of the climate crisis ; septembre 2023. Lien
France Culture ; Brésil : le militant indigène Paulo Paulino Guajajara, défenseur de la forêt, assassiné ; Anne Vigna ; novembre 2019. Lien
France Inter ; Observateurs de pêche : enquête sur un métier à risque ; Anne-Laure Barral : octobre 2024. Lien
Vert ; Entretien avec Marine Calmet : « Les peuples autochtones sont les gardiens de la biodiversité » ; octobre 2024 ; Esteban Grépinet. Lien
Survival International ; site internet de l’ONG. Lien
UNESCO ; Press and planet in danger: safety of environmental journalists; trends, challenges and recommendations, 2024. Lien
Futura ; Dossier Survival Instinct sur Les peuples indigènes menacés. Lien
Vert ; En Colombie, d’anciens combattants des Farc ont abandonné leurs fusils pour restaurer la forêt amazonienne ; Nolwenn Jaumouillé. Lien
Ouest-France ; Brésil : où en est la déforestation de l’Amazonie après quatre années de présidence Bolsonaro ? ; juin 2022. Lien
Wikipedia : biographies des activistes