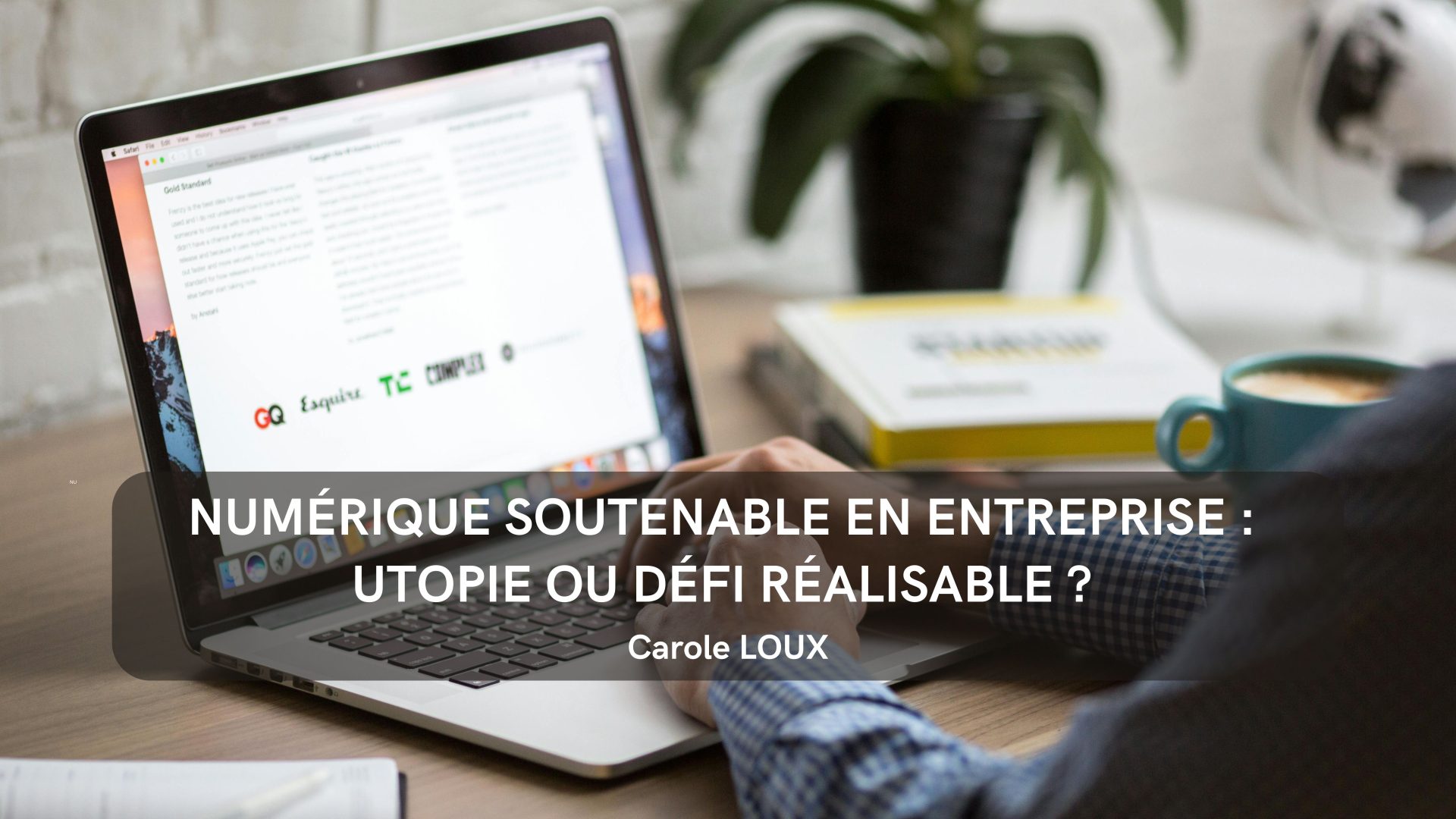Article de Carole Loux (MS EEDD parcours RSEDD 2024-25)
Introduction
Le numérique occupe aujourd’hui une place prépondérante dans nos vies personnelles et professionnelles. Les équipements sont omniprésents, selon sa récente étude [1] le Green IT a quantifié à 30 milliards le nombre d’équipements dans le monde, soit une moyenne de 6 équipements par internaute.
En effet, bien que l’intelligence artificielle (IA) et les data centers soient largement médiatisés de nos jours, le numérique en entreprise ce sont essentiellement des ordinateurs, des téléphones, des terminaux, des écrans, de l’Internet des objets (IoT), des réseaux…et leur volume et leur utilisation ne cessent d’augmenter avec pour résultat une empreinte carbone du numérique pour la France en 2022 de 4,4 % de l’empreinte carbone nationale, soit 29,5 MtCO2e [2]
Pourquoi cet emballement des outils numériques ? Quels sont leurs impacts environnementaux ? Les initiatives de Numérique Responsable / Soutenable en entreprise sont-elles vraiment réalisables et pertinentes ?
Le contexte du numérique en entreprise
Commençons par clarifier le contexte du numérique / de la transformation numérique en entreprise. Cette démarche, qui consiste à intégrer les technologies de l’information (IT) dans l’ensemble des processus de l’entreprise, couvre un vaste scope : de la boîte mail, des outils de travail collaboratif, des visioconférences, du e-learning en passant par l’automatisation des processus, l’optimisation des ressources (matières premières, énergie…), les infrastructures, les logiciels et applications, le stockage et l’analyse des données, le cloud, l’IA générative, les terminaux au sens large… autant d’outils familiers et simplement accessibles qui nous sont devenus indispensables.
Et ils présentent de multiples avantages pour les organisations avec notamment une amélioration de l’efficacité et la productivité, une gestion des ressources optimisée ainsi qu’un engagement client renforcé. Le numérique facilite également la communication et la collaboration des équipes, elle permet une innovation accrue, une meilleure expérience client dans le but d’engendrer plus de revenus.
Interrogées lors du baromètre de la transformation numérique, plus de 79 % (+3 points) des TPE et PME, considèrent que le digital est un véritable atout pour leur activité, notamment en termes de croissance et de rentabilité. [3]
Au regard de la diversité et l’étendue des services rendus, la tendance haussière du marché n’a rien de surprenant. D’après Grand View Research [4] le marché mondial de la transformation numérique pourrait atteindre 4,6 billions de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 26,7 %.
L’impact du numérique
Un impact global colossal : 4,4% de l’empreinte carbone en France [1]
Il est indéniable que le numérique a un impact environnemental conséquent et que la tendance est à l’augmentation.
Comme cité en introduction, selon le rapport de l’ADEME-Arcep publié en 2024,[1] l’empreinte carbone générée pour un an de consommation de biens et services numériques en France en 2022, représente l’équivalent de 4,4 % de l’empreinte carbone nationale soit 29,5 Mt CO2e. Il faut noter que ce chiffre a été réévalué en 2024 en intégrant l’empreinte des data centers étrangers utilisés pour la France. Cette même étude, estime que 11 % de la consommation électrique française est liée aux services numériques soit 51,5 TWh (65 TWh si on prend en compte la consommation électrique des data centers situés à l’étranger) et que 117 millions de tonnes de ressources sont utilisées par an pour produire et utiliser les équipements numériques soit 1, 7 tonnes par français et par an.
Ces chiffres se réfèrent au scope national, sphères privées et professionnelles confondus. La récente étude de Green IT [15] s’est focalisée quant à elle sur le numérique au bureau au niveau monde. Il en ressort que le numérique au bureau consomme 40% du budget soutenable annuel d’un.e .européen.ne . Le budget soutenable, tel qu’analysé par Green IT, étend la notion de budget carbone annuel—soit la quantité maximale de gaz à effet de serre que l’humanité peut émettre sans dépasser le seuil critique – à l’ensemble des impacts environnementaux. Cette approche vise à garantir que l’empreinte écologique du numérique reste compatible avec les objectifs des Accords de Paris, notamment la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.
A l’échelle d’une journée au bureau (220j/an), le tableau 1 liste les impacts associés aux usages numériques d’un utilisateur [15]
| Épuisement des ressources “matières” | 382 kg de terre excavée (5 à 6 fois votre poids) par jour |
| Épuisement des ressources “fossiles” | 1 radiateur électrique de 1000 Watts pendant 8 heures |
| Radiations ionisantes | 92 radiographies des poumons |
| Réchauffement global | 2 kg équivalent CO2, soit 11 kilomètres en voiture thermique par jour |
| Utilisation de l’eau douce | 1620 litres d’eau par jour, soit 27 douches (60 litres) par jour |
Tableau 1 – Équivalence des impacts d’un utilisateur par jour – BENCHMARK GREEN IT 2024 – Green IT
![Selon Green IT [15], mettre en perspective nos usages numériques au bureau par rapport aux enjeux environnementaux, exprimés en pourcentage du budget annuel soutenable d’un Européen (voir Schéma 1), permet de mieux appréhender l’ampleur de l’impact du numérique au regard des limites planétaires.](https://blog-isige.minesparis.psl.eu/wp-content/uploads/2025/05/Image4-2-1024x506.png)
En entreprise, l’utilisation est la phase la plus impactante (monde)
À l’échelle mondiale, la phase d’utilisation en milieu professionnel—soit 8 heures par jour devant un écran—est désormais celle qui génère le plus d’impact environnemental, représentant 60 % de l’empreinte numérique. Cette nouvelle tendance est notamment dû à l’allongement de la durée de vie des terminaux, et une meilleure prise en compte du cloud basé en Asie et aux USA, qui ont fait baisser la part de la phase production dans l’empreinte totale.
Dans un contexte grand public et sur le scope national, la phase de fabrication reste cependant la phase prédominante [2] avec 40% du poids total en 2022. Il est essentiel de souligner que le mix énergétique utilisé lors de la phase d’utilisation influence fortement son impact à l’échelle mondiale. En France, où l’énergie est majoritairement décarbonée, l’impact environnemental de la phase d’utilisation du numérique est réduit par rapport aux pays dont la production électrique repose sur des énergies fossiles.
Un impact en hausse accéléré par l’IA
L’ADEME estime qu’à l’horizon 2050, si rien n’est fait pour réduire l’empreinte environnementale du numérique et que les usages continuent de progresser au rythme actuel, l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler. [2]
Dans l’Union européenne, l’Agence Internationale de l’Energie [6] estime la consommation d’électricité des data centers à un peu moins de 100 TWh en 2022, soit près de 4 % de la demande totale d’électricité de l’UE. La prévision pour 2026 est une consommation d’électricité du secteur près de 150 TWh, soit une augmentation de 150%.
En résumé, l’impact du numérique, c’est un boom de la consommation d’énergie, la hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l’épuisement des ressources non renouvelables. Dans ce présent document, nous avons fait un focus sur l’impact environnemental du numérique. Il faut être également conscient que le numérique a des impacts sociaux et sociétaux non négligeables.
Tendre vers un numérique responsable
Au vu de ces nombreux impacts croissants, réduire l’empreinte écologique du numérique devient indispensable. Cette approche s’inscrit dans le Numérique Responsable, une démarche visant à limiter les effets négatifs du numérique sur l’environnement et la société en favorisant des pratiques plus durables. Le numérique responsable fait l’objet de nombreux guides [7] [8] [9] et dispose de son propre label initialisé par l’Institut du Numérique Responsable : Le label Numérique Responsable [10] dont le but est d’accompagner les organisations vers une transformation écologique et éthique du numérique.
Il existe de nombreuses bonnes pratiques permettant de limiter les impacts du numérique, vous trouverez ci-dessous des exemples considérées comme les plus essentielles :
- Allongement de la durée de vie des équipements
Dans son guide des bonnes pratiques, l’INR note que les impacts environnementaux évités en allongeant d’un an la durée de vie de 1000 équipements représentent 17, 1 t CO2e pour les ordinateurs portables et 7,3 pour les Smartphones en tonnes eq. CO2 évités [7]. - Généraliser le reconditionnement et la réparation
De même, dans le guide, l’INR note que les impacts évités pour achat de 1000 équipements reconditionnés versus du neuf est de 54,9 tCO2e pour les ordinateurs portables et 25,5 tCO2e pour les smartphones [7] - Réduire le taux d’équipement
Les équipements sont-ils vraiment nécessaires ? Type écran de hall, double écran… Est-il possible d’envisager la mutualisation des équipements professionnels et personnels : BYOD (Bring Our Own Device) ou COPE (Corporate Owned, Personally Enabled)? - Améliorer l’efficacité énergétique des équipements notamment des infrastructures & data centers
Privilégier l’achat d’énergie renouvelable, voire en autoconsommation lorsque c’est possible - Eco-concevoir les services numériques
Développer l’éco-conception des services numériques afin de réduire leur impact environnemental, en s’appuyant en particulier sur le référentiel général de l’éco-conception des services numériques (RGESN)[11]. S’assurer de la possibilité d’utiliser les services sur d’anciens terminaux. - Opter pour la location fonctionnelle d’équipements
L’économie de fonctionnalité est une démarche où le client aura uniquement accès à un/des usage(s), il ne possédera pas les équipements. Cette approche va réduire l’impact du numérique en favorisant une meilleure utilisation des équipements et donc une durée de vie prolongée. Elle va notamment favoriser une consommation plus ajustée aux besoins réels. Les utilisateurs vont éviter la surcapacité inutile car ils pourront facilement adapter leurs usages à l’échelle en fonction de leurs besoins. L’ensemble des acteurs de l’IT proposent cette démarche notamment pour les infrastructures. - Réduire les usages au strict nécessaires, réduire le volume des données
Mettre les données au plus près des usages, réduire les vidéos, les mails, les volumes stockés. L’impact des emails est dépendant du nombre de destinataires et du poids des pièces jointes. Sachant que Statistica a estimé à 347 milliards le volume total d’emails professionnels et grand public envoyés et reçus par jour en 2023 [12],nous pouvons estimer que près de 87 tonnes de CO2e sont émises chaque jour, en prenant comme référence l’impact carbone d’un email envoyé à deux destinataires sans pièce jointe, évalué par l’ADEME à 0,25 g CO₂e [16]] Une politique de gestion des emails permet de réduire ce volume. - Assurer le recyclage d’un maximum de matériaux
Le recyclage des produits numériques est actuellement limité : sur la cinquantaine de métaux constituant un équipement numérique moins d’une dizaine sont effectivement recyclés [13]
En complément de ces bonnes pratiques, la loi REEN de 2021 (Réduction de l’Empreinte Environnementale du Numérique) , vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Elle sensibilise les consommateurs, les services publics et les entreprises aux impacts écologiques du numérique et encourage des pratiques plus durables sans toutefois prévoir de sanctions spécifiques.
La loi REEN repose sur cinq axes principaux : la sensibilisation aux enjeux environnementaux du numérique, la limitation du renouvellement des appareils, la promotion de pratiques numériques plus durables, l’amélioration de l’efficacité énergétique des data centers et réseaux et l’intégration d’une stratégie numérique responsable dans les territoires. Concernant la limitation du renouvellement des équipements, la loi encourage leur réparation, leur réemploi et leur réutilisation, tout en généralisant l’éco-conception des services numériques.
Par ailleurs, elle promeut l’optimisation des infrastructures, en particulier les data centers et les réseaux, afin de réduire leur consommation énergétique. La loi REEN précise ainsi dans un cadre règlementaire de nombreuses bonnes pratiques à adopter pour réduire l’impact environnemental du numérique.
Les spécificités des data centers
Bien que concernés par les points susnommés, les data centers comportent certaines spécificités qu’il est intéressant d’évoquer.
L’enjeu d’un data center est de garantir une alimentation électrique constante et sans imperfection 24h/24 et 7j/7. En effet l’électricité alimente les serveurs mais également et surtout le système de refroidissement, point névralgique d’un data center.
Ce système qui a pour objectif de maintenir une température optimale afin d’éviter la surchauffe des équipements, représente 40% de l’énergie consommée par un data center [14]. L’enjeu pour réduire l’impact des data centers est donc d’améliorer l’efficacité énergétique du système de refroidissement en s’adossant aux différentes technologies existantes.
Par exemple, la société Vertiv a mené une étude comparative qui montre que la mise en œuvre de refroidissement liquide a entrainé une réduction de 18% de l’alimentation du site par rapport au refroidissement à air à 100% [16].
De plus, la récupération de la chaleur fatale est également un enjeu clé des data centers, cette chaleur récupérée peut servir à chauffer des piscines ou plus souvent un réseau de chauffage urbain. Cette approche présente des intérêts écologiques et économique probants tout en permettant d’économiser des émissions de carbone.
Il existe cependant certaines limites
Bien que la plupart des actions soient raisonnablement envisageables, la mise en œuvre d’un numérique responsable peut rencontrer plusieurs obstacles. D’abord, le coût financier peut être un frein. En effet, adopter des pratiques plus durables implique souvent des investissements initiaux, notamment pour l’achat d’équipements plus fiables et plus réparables.
Cela implique également des investissements temps-homme de la part des équipes IT et équipes achats pour opérer les analyses puis les changements nécessaires. La complexité technique de certaines solutions, comme l’éco-conception des services numériques ou la réduction de la consommation énergétique des data centers, peut également nécessiter des compétences spécifiques qui ne sont pas toujours disponibles en interne nécessitant l’appel à des prestataires externes ou à la formation des collaborateurs.
Ensuite, les collaborateurs et les entreprises peuvent percevoir ces nouvelles pratiques comme contraignantes et dévalorisantes. Par exemple l’allongement de la durée de vie des équipements ou le recours à des équipements reconditionnés peut être ressenti comme une perte d’avantage par les collaborateurs.
Dans la sphère professionnelle, le numérique nous a permis d’avoir de nouveaux modes de fonctionnement plus efficaces, plus rapides. L’un des nouveaux défis consiste à concilier les avancées du numérique avec une utilisation responsable et durable. Il est essentiel d’adopter une utilisation raisonnée du numérique tout en tenant compte des possibilités exponentielles offertes par l’IA et la frénésie que suscite l’IA générative.
Trouver le juste équilibre entre un usage pertinent et l’impact écologique est donc primordial. Pour exemple, est-ce vraiment indispensable d’utiliser ChatGPT d’OpenAI lorsque l’on sait que la consommation moyenne d’électricité d’une recherche est 10 fois plus élevé (2,9 Wh par requête) qu’une recherche Google classique (0,3 Wh d’électricité) [6] ?
Conclusion
Un numérique plus soutenable en entreprise est envisageable au vu des nombreuses pistes d’action. Comme pour toute question liée aux impacts environnementaux, la sobriété demeure un enjeu essentiel à prendre en compte. Sans surprise, le plus efficace pour réduire son impact est de ne pas avoir d’activité.
Le scénario de sobriété des usages du numérique est malheureusement un scénario contre tendanciel qui nécessite une modification importante de nos modes de travail déjà largement chamboulés par l’IA. De plus, pour instaurer une sobriété des usages, il est crucial de bénéficier d’indicateurs de mesure de l’impact par usage. Ces indicateurs sont complexes à définir à ce jour.
Pour adopter une politique de Numérique Responsable / Soutenable efficace, les organisations doivent relever un défi majeur : trouver le juste équilibre entre productivité et impact. Il s’agit de concilier l’usage du numérique, sa pertinence et son empreinte écologique, tout en conservant efficacité, performance et compétitivité. Un véritable challenge pour une transition numérique plus durable et réfléchie.
Sources
[1] Étude – Impacts environnementaux du numérique dans le monde- Green IT – lien
[2] Évaluation de l’impact environnemental du numérique en France – ADEME-Arcep – Janvier 2025 Lien
[3] Publication du baromètre 2024 de la transformation numérique des TPE et PME | Direction générale des Entreprises. Lien
[4] Digital Transformation Market Size And Share Report, 2030 – Grand View Research – lien
[5] 5 tendances du cloud et leurs conséquences pour la DSI – CIO ONLINE, novembre 2024 – lien
[6] Electricity report – Agence Internationale de l’Energie – 2024 – lien
[7] Guide de bonnes pratiques numérique responsable – INR – Lien
[8] Référentiel du label Numérique Responsable Lien
[9 ] Programme Alt Impact pour se mobiliser pour la sobriété numérique – lien
[10] Label Numérique responsable –lien
[11] Référentiel général d’éco-conception de services numériques – Arcep – Arcom – Lien
[12] Email Statistics Report, 2023-2027 – The Radicati Group Inc – lien
[13] Avis de l’ADEME – Numérique & environnement : entre opportunités et nécessaire sobriété – Janvier 2025 – Lien
[14] Data centers : la face pas si cachée du numérique – ADEME Magazine – janvier 2025 – Lien
[15] Benchmark Green IT 2024 – Green IT – lien
[16] Mesure de l’impact sur le PUE et la consommation électrique de l’introduction du refroidissement liquide dans un datacenter refroidi à l’air – Mai 2023 – Vertiv – lien
Etude complète : Power Usage Effectiveness Analysis of a High-Density Air-Liquid Hybrid Cooled Data Center – American Society of Mechanical Engineers (ASME) – lien
[17] Impact CO2 – Outils de l’ADEME pour calculer son impact carbone – lien