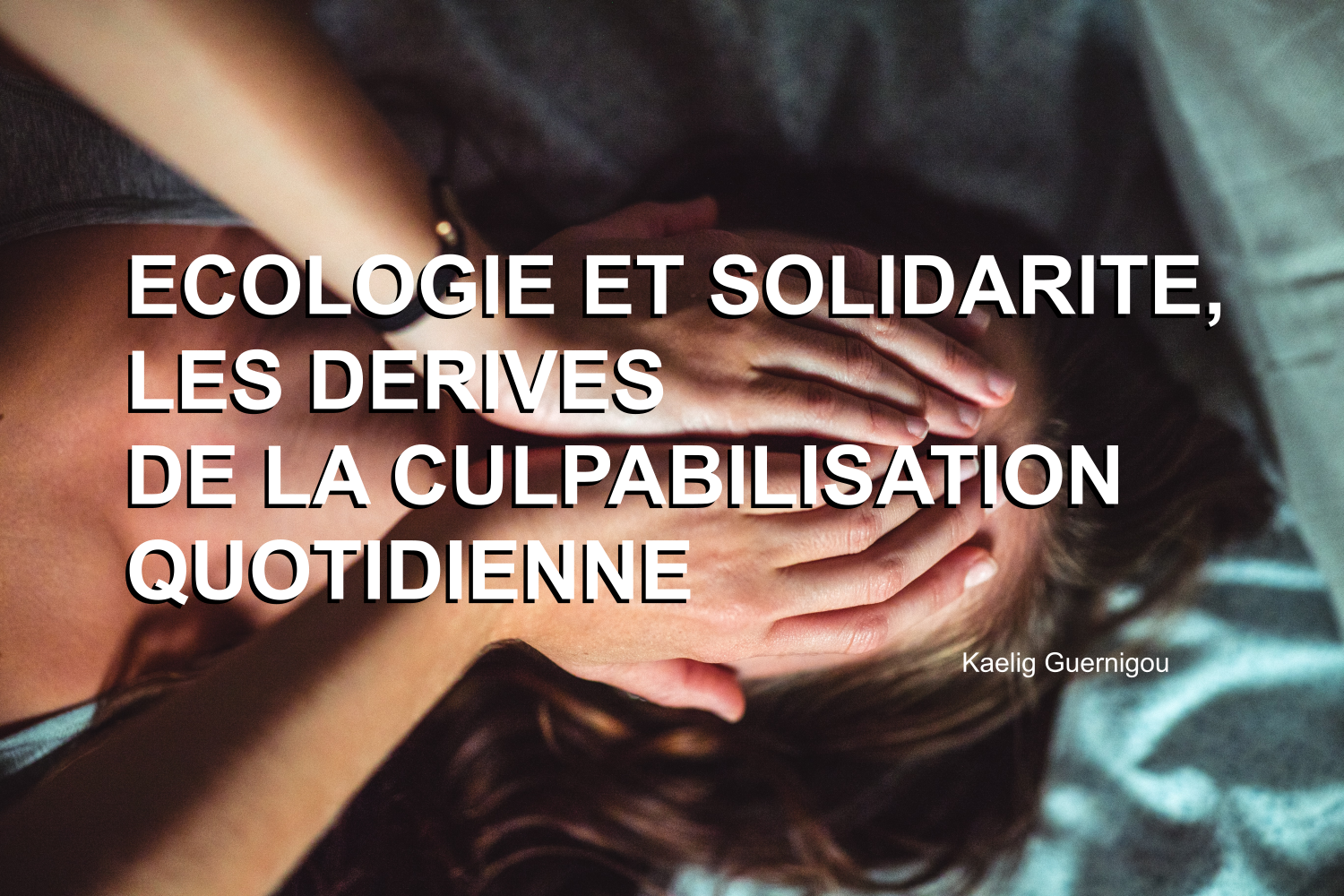Article de Kaelig Guernigou (IGE 2020)
Le 23 septembre 2019, au sommet sur le climat des Nations Unies, Greta Thunberg a prononcé un discours désormais bien connu. La lycéenne, capable de mobiliser des millions de jeunes autour de l’urgence environnementale, a réussi à marquer les esprits à travers le monde. « How dare you ? » (Comment osez-vous ?), répète-t-elle plusieurs fois face aux chefs de l’Etat.
« Je ne devrais pas être là, je devrais être à l’école, de l’autre côté de l’océan. […] Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. […] Vous nous avez laissés tomber. Mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis : nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça »
Dans ce discours, Greta utilise un outil dont on parle peu et qui est pourtant très présent dans notre société : la culpabilisation. A l’écoute des paroles pleines de colère de la jeune fille, la culpabilité monte dans l’esprit des auditeurs, notamment vis-à-vis des générations futures.
Ce sentiment, nous le connaissons tous. C’est à l’âge de trois ans que la notion de culpabilité est assimilée par l’individu. Son influence sur nos comportements a fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Outre son rôle social, la culpabilité permet d’orienter les prises de décision et les actes des individus. Elle est utilisée dans toutes les sphères de la société, aussi bien en marketing qu’en politique. Nous le retrouvons souvent dans des discours autour de la protection de l’environnement ou autour de la solidarité. Mais l’usage démesuré de la culpabilité ne produit pas toujours les effets escomptés sur le comportement. Ce sentiment peut en effet être à l’origine de nombreuses dérives.
Les effets de la culpabilité sur le cerveau et le comportement des individus
Selon June Price Tangney, chercheuse et professeure de psychologie, à la différence de la honte, la culpabilité renforce le désir de réparation. Lorsque l’individu transgresse une norme morale et a le sentiment de faire du mal, il tente de corriger son comportement pour rééquilibrer ses relations avec autrui. Par exemple, lorsqu’il a conscience des enjeux environnementaux et sociétaux contemporains, certaines consommations comme l’achat d’un pot de Nutella ou un déplacement en avion, font naître en lui de la culpabilité. Ce sentiment l’amène ensuite à s’interroger sur sa vision du bien commun. Cette réflexion, qui provient en fait d’un sentiment de culpabilité, va générer une modification des comportements. L’individu préférera par exemple acheter de la pâte à tartiner sans huile de palme et prendre le train.
L’influence de la culpabilité sur le comportement est importante pour permettre le « vivre ensemble ». En effet, d’après Edoardo Pappaianni, « une société sans culpabilité ressemblerait à une société hyper individualiste, dans laquelle l’impact des actions sur les autres ne serait pas le moins du monde pondéré ». Ce sentiment est d’ailleurs largement utilisé dans les messages de prévention et de don. Si, dans ces situations, la culpabilisation peut sembler intéressante, la question se pose lorsqu’elle intègre les stratégies marketing. En été 2019, Coca-Cola lançait une campagne de publicité plutôt étonnante, autour du slogan « Help Us Recycle » (« Aide-nous à recycler »). Une manière d’inciter à l’achat, tout en orientant l’attention du consommateur vers ses propres pratiques de recyclage plutôt que vers l’impact environnemental de la firme.
La culpabilité est omniprésente dans notre quotidien. Or, se sentir coupable pour tout et tout le temps peut se révéler contre-productif. En effet, à trop forte dose, la culpabilité peut rapidement avoir des effets pervers. Selon le neurologue à l’Université de Genève, Patrick Vuilleumier, « si le lien culpabilité-dépression n’est pas scientifiquement démontré, les individus dépressifs notent souvent d’énormes sensations de culpabilité. Et si les réseaux liés à la culpabilité sont trop stimulés, il est probable que la dynamique du cerveau proche des anomalies de la dépression soit favorisée ». Selon le chercheur, « la culpabilité excessive est caractéristique de nombreux troubles : alimentaires, obsessionnels compulsifs ». Par ailleurs, des études montrent que la « solastalgie » (terme inventé en 2003 par le philosophe australien Glenn Albrecht pour désigner l’expérience d’un changement environnemental vécu négativement) ou l’éco-anxiété, seraient de la culpabilité refoulée plutôt qu’un manque d’espoir en l’avenir. Des études sont encore plus inquiétantes puisqu’elles montrent que le sentiment de culpabilité peut provoquer l’effet inverse de celui attendu. C’est ce qu’a montré le psychologue américain Jack Williams Brehm en 1966. D’après lui, un mécanisme psychologique, appelé réactance, fait que volontairement ou non, un individu peut tenter de maintenir sa liberté d’action quand il la sent menacée. Il existerait ainsi un seuil de tolérance à la culpabilité, au-dessus duquel l’acte de réparation disparaitrait.
Dans Agir avec le désespoir environnemental, Joanna Macy explique également que face à l’incertitude qui règne sur la possible existence de générations après la nôtre, un mélange de multiples sentiments apparait. Il y a en effet de la colère, de la terreur et de la douleur. Mais il y a aussi de la culpabilité, « puisqu’en tant que membres de la société, nous nous sentons impliqué.e.s dans cette catastrophe et hanté.e.s par la pensée que nous devrions être capables de l’éviter ». Selon l’auteure, la peur de se sentir coupable « nous emprisonne et inhibe notre action », notamment lorsqu’il s’agit de modifier notre mode de vie. « Admettre de la détresse pour notre monde nous ouvre à un sentiment de culpabilité ». Pourtant, l’auteure indique qu’il est « difficile de fonctionner dans notre société sans renforcer les conditions mêmes que nous dénonçons, et le sentiment de culpabilité qui en découle rend ces conditions, et notre indignation envers elles, plus difficiles encore à regarder en face ». Ainsi, selon elle, la peur d’affronter ce sentiment limiterait notre pouvoir d’agir.
Le sentiment de culpabilité très présent dans notre société peut donc être dangereux. Pourtant, le contexte social et environnemental actuel semble particulièrement bien se prêter aux actions de culpabilisation, et notamment envers certains groupes sociaux. Les femmes semblent plus sujettes au sentiment de culpabilité lorsqu’il s’agit du changement climatique et de la destruction de l’environnement. De leur côté, les personnes précaires, sont victimes de culpabilisation concernant la gestion de leurs dépenses. Elles sont aussi souvent accusées d’acheter des produits mauvais pour la santé et pour l’environnement.
Le sentiment de culpabilité quotidien et la culpabilisation de certains groupes sociaux
La charge mentale transformée en charge morale
Face au défi environnemental, de plus en plus de ménages modifient leurs manières de consommer et se lancent dans des démarches écologiques. Par exemple, certains foyers font le choix de réduire drastiquement leurs déchets, de ne plus acheter de plats préparés, de n’acheter que des produits bio et de saison ou de fabriquer leurs produits ménagers. Ces changements d’habitudes bouleversent le quotidien et accroissent la charge de tâches ménagères à réaliser.
Plus portées par les femmes, ces initiatives pèsent sur ces dernières qui sont déjà souvent plus impliquées que leur conjoint dans les foyers. En effet, plusieurs études sociologiques montrent que les mères ont la charge des deux tiers des tâches domestiques et de trois quarts des tâches parentales. Mais l’exécution des tâches ménagères n’est pas le seul poids qui pèse sur les femmes. En 2017, la bloggeuse, ingénieure informatique et auteure Emma popularise le concept de charge mentale dans une de ses bandes dessinées. Elle explique que les femmes, en plus d’exécuter les tâches ménagères, portent la charge mentale, c’est-à-dire tout ce qui concerne les tâches ménagères dans leur planification. « Dans les foyers, ce sont les femmes qui pensent à tout ce qu’il faut faire dans la semaine pour faire tourner la vie familiale, et qui anticipent qui va devoir s’en charger ».
Le poids de la charge mentale qui pèse sur les femmes fait l’objet de nombreux débats. Pour certains, le cerveau des hommes n’est pas fait pour réaliser plusieurs choses en même temps, d’où la différence de comportement. Pour Emma, ce n’est pas une différence d’état biologique entre l’homme et la femme qui explique ces comportements mais l’éducation. C’est d’ailleurs ce qu’explique Magali Trelohan, enseignante-chercheuse à la South Champagne Business School, pour qui la théorie de la socialisation permettrait d’expliquer cette différenciation : « On apprend plus aux petites filles qu’aux petits garçons à se soucier des autres. Et ça s’étend jusqu’aux soucis de la nature. C’est ce que l’on appelle “le care” en anglais. […] C’est le “prendre soin”. Quand elles deviennent grandes, elles se sentent plus préoccupées par les autres, plus préoccupées par l’environnement. ».
En fait, les femmes ne sont pas seulement celles qui exécutent les tâches ménagères, elles sont aussi plus investies que les hommes en écologie, et notamment lorsqu’il s’agit de passer à l’action, par exemple avec des écogestes. En juillet 2018, ce constat est confirmé par une étude de Mintel, une société d’études de marché basée à Londres. En Grande-Bretagne, où l’étude a été conduite, 71 % des femmes interrogées déclaraient avoir adopté un mode de vie plus éthique que l’année précédente, contre 59 % des hommes. Elles étaient 77 % à déclarer recycler régulièrement. Ils n’étaient que 67 %. En 2015, une étude menée dans 11 pays dits développés, le think tank américain Pew Research mettait déjà en avant le fait que les femmes se sentent plus préoccupées et plus concernées que les hommes par le changement climatique. Lors des élections européennes de 2019, deux fois plus de françaises (17%) que de français (9%) ont voté Europe Ecologie les Verts, selon une enquête Ipsos Steria pour France Télévisions.
Cependant, si dans la sphère privée les femmes prennent les initiatives, elles sont bien moins présentes dans la sphère publique. En effet, dans les instances de décision, les cercles activistes ou les associations, ce sont les hommes qui sont majoritairement représentés. Seulement 6 % des postes ministériels en charge des politiques énergétiques et 15% des conseils du Fonds vert pour le climat sont occupés par des femmes. Il y a seulement un quart de femmes dans les métiers STEM (sciences, technologies et métiers d’ingénieur et mathématiques). Ces quatre domaines sont pourtant indispensables et sont centraux pour la protection environnementale.
Ainsi, au sein du foyer, même si l’ensemble de la famille se préoccupe de l’environnement, ce sont souvent les femmes qui s’exercent à rendre compatible les pratiques quotidiennes et le respect de l’environnement. On remarque désormais que la charge mentale se traduit en charge mentale écologique, ou en charge morale. Tous ces efforts demandent du temps et de l’énergie. Convaincues du bienfait de la démarche, le retour en arrière de ces femmes devient très culpabilisant. Selon la dessinatrice Emma, le vrai problème « c’est que le gouvernement et les entreprises ont détourné le débat sur les gestes du quotidien comme seule réponse au changement climatique. Et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui beaucoup de femmes se sentent coupables de ne pas réussir à sauver la planète ». Pourtant, il faut bien rappeler que les citoyens, les entreprises et les gouvernements ont tous leur rôle à jouer pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux.
La culpabilisation des pauvres
Dans son livre « Où va l’argent des pauvres », le sociologue Denis Colombi met en avant la culpabilisation que subissent les pauvres vis-à-vis de la gestion de leur budget. Les pauvres, qu’il définit comme des individus étant en situation monétaire de privation et ayant le sentiment d’être dépendant de l’aide de la collectivité, sont sans cesse jugés sur leurs dépenses et leurs modes de vie. Les reproches sont en effet nombreux : pourquoi les pauvres se permettent-ils certains plaisirs ? Pourquoi acheter des vêtements de marques, du Nutella, ou un smartphone lorsqu’on manque d’argent ?
Selon le sociologue, « intuitivement, on se plait à penser que si les pauvres géraient leur argent comme les riches, ils seraient eux-mêmes riches ». Il met notamment en avant les débats très présents dans la sphère politique sur le versement des aides sociales et « l’assistanat ». Pour certains politiques, les pauvres sont incapables de gérer leur argent. Ils sont indignes de confiance et profitent des aides pour ne pas travailler. A partir du moment où ils n’apportent pas de valeur à la société, ils ne doivent recevoir aucune aide financière. Pour d’autres, cette aide doit être orientée vers des dépenses précises qui peuvent être contrôlées. On ne devrait pas laisser, au pauvre, le choix de la dépense. C’est par exemple ce que préconisait la femme politique Samila Ghali, à l’été 2019, concernant les fournitures scolaires. Pour elle, il vaudrait mieux verser les sommes aux écoles pour s’assurer qu’elles soient utilisées pour l’achat de matériel scolaire, plutôt que de laisser le choix de la dépense aux parents précaires.
Selon Denis Colombi, « tout le monde a un avis sur ce que les pauvres devraient faire de leur argent. Tout le monde pense qu’il s’en sortirait mieux qu’eux à leur place… et donc tout le monde se convainc que, quand même, les pauvres méritent au moins un peu leur situation ». Dans son livre, il montre l’importance de la sociologie et des études empiriques pour décrire et expliquer le choix et les dépenses des pauvres, qu’il décrit comme parfaitement raisonnés et rationnels.
Le sociologue explique finalement que le pauvre est un très bon gestionnaire. Loin d’être feignant, le pauvre arbitre entre le revenu qu’il pourrait percevoir d’un travail, et les dépenses engendrées par celui-ci (transport, repas, garde d’enfants). C’est pourquoi, il est parfois irrationnel de travailler. Ensuite, l’épargne classique, bien que largement plébiscitée pour sortir de la misère, est tout à fait inadaptée aux sommes minimes que les pauvres perçoivent tous les mois. Outre les sacrifices auxquels ils devraient se plier, l’épargne ne leur permettrait pas de sortir de la pauvreté. Face à un avenir de toute façon difficile, « il n’est pas irrationnel de souhaiter profiter dans le présent puisque cela ne changera rien, si ce n’est à la marge, aux contraintes futures ». Dépenser toute sa paie dès sa réception n’a donc rien d’irresponsable. D’ailleurs, souvent, les pauvres épargnent, mais autrement. Ils épargnent en nature pour profiter des promotions du moment et pour éviter de dépenser l’argent dans quelque chose de moins utile. Ensuite, le sociologue rappelle que « les parents pauvres sont soumis aux mêmes injonctions et aux mêmes normes que les autres : prendre soin de leurs enfants, s’assurer de leur bonheur et, surtout, les protéger du manque ». Ainsi, selon lui, plutôt que de culpabiliser les parents précaires pour l’achat de vêtements de marque à leurs enfants, il semble plus pertinent de lutter contre les moqueries et le harcèlement à l’école. Quant à certains achats jugés « non prioritaires », le sociologue rappelle l’intérêt du smartphone notamment pour les sans domicile et les migrants, qui n’ont parfois que cet outil pour communiquer avec leurs proches, pour gérer l’administratif, ou pour postuler à des offres d’emplois.
Dans son livre, Denis Colombi déconstruit l’idée que l’on se fait de la pauvreté. Cette situation n’est pas une punition : une personne ne devient pas pauvre par la mauvaise gestion de son comportement. La pauvreté c’est souffrir du manque d’argent (privation économique) et c’est l’expérience de la stigmatisation qui l’accompagne. C’est la pauvreté qui influence et modèle le comportement des individus. Selon lui, « aussi longtemps que l’on pense que lutter contre le crime est la même chose que lutter contre la pauvreté, on se condamnera à ne régler ni l’un ni l’autre ». Le sociologue montre finalement que pour lutter contre la pauvreté, le transfert d’argent s’avère être la solution la plus efficace. Il avance notamment l’intérêt du revenu universel, car il permettrait de laisser la liberté à chacun de dépenser comme il le souhaite, sans culpabilisation.
Les deux exemples précédents sont particulièrement intéressants. En effet, ils montrent que les femmes se sentent plus coupables que les hommes pour les sujets environnementaux, et que les personnes précaires sont culpabilisées sur la manière dont elles gèrent leurs dépenses. Or, il faut noter que les femmes se trouvent aussi plus souvent que les hommes dans des situations de précarité. Une étude du Conseil économique, social et environnemental montre que 72% des travailleurs pauvres sont des femmes et que 82% des temps partiels sont tenus par des femmes. Le parallèle entre ces deux situations où la culpabilisation est omniprésente, est finalement assez troublant, puisque ce sont aussi les femmes et les personnes précaires qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique.
Ainsi, le sentiment de culpabilité est un outil politique, de communication et de marketing qui n’est pas toujours bien utilisé. La limite est parfois fine entre la sensibilisation et la culpabilisation. Chacun perçoit un message à sa manière, en fonction de son vécu et de son éducation. Selon l’objectif du locuteur et la force de ses propos, la culpabilisation peut mener à l’effet inverse de celui recherché et même s’avérer dangereuse. Pour mobiliser les citoyens en faveur de l’environnement, peut-être faudrait-il informer et sensibiliser, plutôt que d’être en constante culpabilisation de l’autre. De la même manière, pour faire face aux enjeux de pauvreté, peut-être vaudrait-il mieux s’orienter vers des démarches de responsabilisation et de solidarité envers les personnes précaires. Finalement, pour affronter les défis environnementaux comme les défis sociétaux contemporains, il convient de s’interroger sur la forme de nos discours et sur les conséquences de cette culpabilisation quotidienne.
–
Sources
Barba Dorothée, « Combien pèse la charge mentale ? », france inter, juillet 2017 https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-11-juillet-2017
Cadu Florian, « Culpabilité, le risque de l’overdose », Socialter, décembre 2020, numéro 43, https://www.socialter.fr/article/culpabilite-le-risque-de-l-overdose
Colombi Denis, Où va l’argent des pauvres, Payot, 2020.
Coulet Sarah, « L’écologie serait-elle une affaire de femmes ? », France culture, aout 2020, https://www.franceculture.fr/environnement/lecologie-serait-elle-une-affaire-de-femmes.
Guérineau de Lamérie Nina, « Fatiguées de culpabiliser », », Socialter, numéro 43, décembre 2020-janvier 2021
https://www.socialter.fr/article/fatiguees-de-culpabiliser
Hache Emilie et Notéris Emilie, RECLAIM : Anthologie de textes écoféministes, Cambourakis, 2016
Joyeux Henri, « Pourquoi les femmes sont plus touchées par la précarité que les hommes », franceinfo, 2014
Marchand Laure, « Charge mentale écolo : les femmes en première ligne», Marie Claire, mai 2020
https://www.marieclaire.fr/charge-mentale-ecolo-ecofeminisme,1348635.asp
Ministère de la transition écologique, « Femmes et climat, quels liens ? », 2019,
https://www.ecologie.gouv.fr/femmes-et-climat-quels-liens
Trelohan Magali. « La persuasion des associations environnementales visant l’adoption de comportements pro-environnementaux par les usagers récréatifs du littoral ». These de doctorat, Lorient, 2017. https://www.theses.fr/2017LORIL447.
«Comment osez-vous ?» : le discours plein d’émotion de Greta Thunberg à l’ONU, Le Parisien, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=gEanyDxn0UY.
« UK Women Try to Live More Ethically than Men », Mintel https://www.mintel.com/press-centre/social-and-lifestyle/the-eco-gender-gap-71-of-women-try-to-live-more-ethically-compared-to-59-of-men.
Quinton Hugo, « Les femmes sont les premières victimes du changement climatique », Consoglobe, 2015
https://www.consoglobe.com/femmes-victimes-changement-climatique-cg